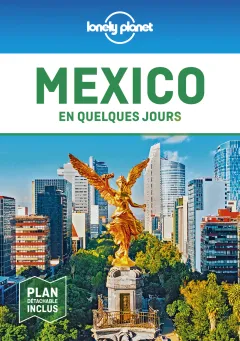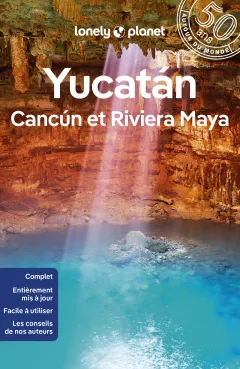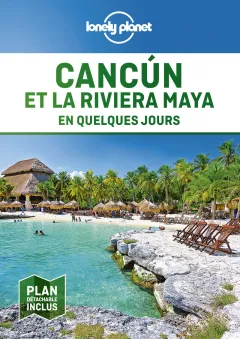-
Publié le 11/02/2014 7 minutes de lecture
Prenez un pays chaud, riche d'une culture plurimillénaire. Mêlez-y des couleurs vives, la ferveur de fêtes traditionnelles. Il n'est même pas besoin d'ajouter une goutte de tequila pour obtenir cette ambiance explosive qui imprègnent tant de films tournés au Mexique.
1. Los Olvidados (Mexico) - Luis Buñuel, 1950, Mexique
Cela se passe à Mexico, mais cela pourrait se passer ailleurs. Les premières images du film, des vues de New York, Paris et Londres, associent de manière étroite le développement des grandes cités modernes à la misère des «oubliés» s'enlisant dans leurs banlieues. Entre le néoréalisme, courant cinématographique né en Italie dénonçant la misère sociale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et le surréalisme, dont Luis Buñuel fut, avec Un Chien andalou et L'Âge d'or, le plus illustre cinéaste, il n'y a qu'une différence de préfixe que le cinéaste espagnol eut tôt fait d'effacer. En émaillant de scènes oniriques et terrifiantes sa description sans fioritures d'une jeunesse réduite au cercle vicieux de la criminalité, Buñuel dévoile la profondeur du mal causé par une société inégalitaire, dès l'enfance, aux laissés-pour-compte.
La ville de Mexico se divise en seize delegaciónes (arrondissements), elles-mêmes divisées en « colonias » (quartiers). C'est dans la Colonia Roma, où vécurent notamment Fidel Castro, William S. Burroughs, Jack Kerouac et Carlos Fuentes, que Buñuel tourna une grande partie des extérieurs du film, et plus particulièrement dans le cœur historique du quartier, surnommé La Romita. Le cachet historique y est l'un des plus prononcés à Mexico, accumulant cafés et places ombragées, édifices à l'architecture de style néocolonial et Belle Époque.
2. L'Assassinat de Trotsky (Mexico) - Joseph Losey, 1971, France/Italie/Grande-Bretagne
Après la Turquie et la France, Léon Trotsky et son épouse avaient trouvé à refuge à Mexico, où Joseph Staline n'avait pas renoncé à faire supprimer son rival le plus gênant. Joseph Losey, en confiant le rôle du révolutionnaire à Richard Burton et en reconstituant à l'écran le couple Romy Schneider/Alain Delon, fit des trois derniers mois de la vie de Trotsky dans la chaleur mexicaine un glaçant drame psychologique.
Il y a en réalité deux mises à mort dans le film. Joseph Losey a tenu à filmer la plus importante, celle de Trotsky, à l'endroit où elle eut effectivement lieu, c'est-à-dire dans la demeure où le révolutionnaire passa les quatre années de son exil mexicain. Située dans la delegación de Coyoacán, au sud du centre de Mexico, non loin de la Casa Azul de Frida Kahlo et Diego Rivera, cette maison est aujourd'hui un musée, où le bureau de Trotsky, macabre scène du crime, a été conservé tel quel. La seconde mise à mort est celle d'un taureau, filmée dans les arènes de Mexico – les plus grandes au monde. Pour cette scène à la forte portée symbolique, où la véritable nature du personnage interprété par Alain Delon perce sous le masque, Losey a filmé une véritable corrida, et s'est permis un petit anachronisme, la Plaza de Toros n'ayant été inaugurée qu'en 1946.

3. Au-dessous du volcan (Cuernavaca, Popocatepetl) - John Huston, 1984, États-Unis
Il fallait bien la carrure de John Huston pour porter à l'écran ce roman réputé inadaptable qu'est Under the Volcano, de Malcolm Lowry. Tout y est question de degrés: ceux du mercure dans les rues de Cuernavaca, ceux de l'alcool qu'ingurgite Geoffrey Firmin, consul britannique en déshérance amoureuse et morale et ceux du discours des différents narrateurs dans le texte. Le film de John Huston fut, en quelque sorte, l'addition d'un degré supplémentaire, celui de la caméra, certes, mais surtout celui du rapport du cinéaste lui-même au pays. John Huston connaissait bien le Mexique, notamment pour y avoir tourné Le Trésor de la Sierra Madre et La Nuit de l'iguane; la terre porte en germe ses récurrences d'artiste, l'illusion fiévreuse et la déroute que constitue l'épuisement de sa poursuite, avec la folie, le dérèglement, comme colonne vertébrale.
Cuernavaca (que Malcolm Lowry appelle Cuauhnáhuac, son nom nahuatl) est la capitale de l'État de Morelos, à une centaine de kilomètres au sud de Mexico. À l'horizon, la silhouette conique du Popocatepetl, deuxième plus grand volcan d'Amérique du Nord, et de l'Iztaccíhuatl, dont la forme évoque une femme allongée. C'est sous le patronage de ces deux volcans que la fête des Morts, au cours de laquelle le pays se pare de crânes et de couleurs, se déroule, dans le roman et dans le film.
4. Y Tu Mamá También (Mexico/Oaxaca) - Alfonso Cuarón, 2001, Mexique
Ça commence dans un lit, ça se passe dans une voiture, sur la plage, sous l'eau, et ça se finit dans un café. Trois corps lancés sur la route, traversant la campagne mexicaine à la recherche d'une plage mi-rêvée, mi-mentie: la Boca del Cielo, la bouche du ciel. Dans les trois corps, deux garçons adolescents et une fille, dix ans plus âgée, mais l'âge et le sexe comptent moins que l'exploration des possibilités qu'ils offrent. Insolemment sensuel et cependant gravement lucide sur les barrières morales et politiques d'un Mexique au tournant de son histoire politique, le film d'Alfonso Cuarón s'imposa comme le plus grand succès international du nouveau cinéma mexicain, et révéla le jeune Gael Garcia Bernal.
Itinéraire de Mexico au rêve, et retour. La fuite de la capitale, au début du film, est pleine des promesses et des fantasmes qu'une destination imaginaire autorise ; pourtant, la plage superbe, les personnages et l'équipe du tournage la trouvèrent bel et bien, à Huatulco et Puerto Escondido, dans l'État d'Oaxaca, tout au sud du Mexique, sur la côte du Pacifique. Les deux localités côtières sont les plus touristiques de la région, et attirent un grand nombre de surfeurs de toutes nationalités, notamment durant les compétitions qui s'y tiennent en novembre chaque année.
5. La Vengeance du serpent à plumes (Chichén Itzá) - Gérard Oury, 1984, France
Gérard Oury reste le cinéaste français ayant attiré le plus de spectateurs dans les salles obscures hexagonales, ses plus grands succès reposant sur un cocktail de comédie et d'aventure, La Grande Vadrouille et Le Corniaud en tête. Dans les années 1980, l'aventure eut pour cadre le Mexique, la comédie eut pour visage Coluche, et Oury y adjoint une touche érotique de choix en confiant à Maruschka Detmers, révélée un an plus tôt par Prénom Carmen de Jean-Luc Godard, le rôle d'une séduisante terroriste.
Qu'il se nomme Quetzalcóatl, Tohil ou Kukulkán, le serpent à plumes reste la plus importante divinité de l'Amérique centrale précolombienne, figurant à la fois l'éternité à travers le concept de réincarnation, et se rattachant aussi aux éléments de la Terre, du ciel et de l'océan. L'une de ses plus monumentales représentations se trouve sculptée au pied de la pyramide de Chichén Itzá, ancienne ville maya dont les vestiges forment le complexe archéologique majeur du Yucatán, où la fin du film a été tournée. Classé à l'Unesco, c'est l'un des plus importants sites touristiques du Mexique, et l'un des trésors les mieux conservés de la civilisation maya. L'observatoire astronomique permet d'éprouver le rôle essentiel que jouait le temps et le ciel dans l'architecture maya, dont l'effet le plus saisissant reste l'apparition de l'ombre du serpent à plumes deux fois par an lors des équinoxes de printemps et d'automne, au moyen d'un savant jeu de lumières, au pied de la pyramide.

6. Frida (Casa Azul, Mexico) - Julie Taymor, 2002, États-Unis
Le Mexique, couleurs vives, destins brûlés vifs. La peinture de Frida Kahlo ne s'est pas pour rien imposée, au fil du temps, comme l'œuvre picturale la plus fascinante non seulement du Mexique, mais de toute l'Amérique latine, dépassant même en réputation – et sur le marché de l'art – celle de son mari Diego Rivera. Si un biopic d'origine américaine devait être consacré au couple mexicain, il est heureux que les studios Miramax aient confié le projet à un autre couple, assez éloigné d'Hollywood: celui formé par la metteuse en scène Julie Taymor et le compositeur Elliot Goldenthal, qui remportera un oscar pour son travail sur le film. Installé à New York, le tandem, qui se fit remarquer pour ses créations déjantées à Broadway (The Green Bird, Juan Darién) et ses adaptations littérales et audacieuses de Shakespeare (Titus, et plus récemment The Tempest), fait se fondre le douloureux destin de Frida (interprétée par l'actrice mexicaine Salma Hayek) dans l'artifice assumé d'une inventivité visuelle et musicale hors normes.
C'est à Coyoacán et dans la Casa Azul, où Kahlo et Rivera vécurent vingt-cinq ans, que Julie Taymor tourna une grande partie du film, aidée en cela par l'aspect très années 1930 que le quartier, très touristique, a conservé. La Casa Azul est naturellement devenue le musée Frida Kahlo, qui conserve quelques-unes de ses œuvres, et l'aspect d'époque de plusieurs pièces.
7. El Topo (Nuevo León) - Alejandro Jodorowsky, 1970, Mexique
Refusé par les distributeurs américains qui se le refilaient comme on se refile une patate brûlante, puis projeté à minuit dans un cinéma de New York, le Elgin, El Topo passa brusquement du statut de film maudit à celui de film culte, faisant chaque nuit salle comble avec un public médusé, baignant dans la fumée de marijuana. Le «cinéma de minuit» venait de naître, portant ensuite aux nues La Nuit des morts-vivants et le Rocky Horror Picture Show, et servant de rampe de lancement à David Lynch et John Waters. Le parcours du Chilien Alejandro Jodorowsky jusqu'à ce succès new-yorkais sans précédent, eut pour étape déterminante le désert mexicain, où il réalisa en 1969 ce western hallucinatoire, relatant la mue d'un bandit sans foi ni loi. L'ultra-violence y est élevée au rang de signe métaphysique et d'authentiques freaks défilent devant la caméra, chargeant symboliquement la «normalité».
Au nord-est du Mexique, le très aride État du Nuevo León, frontalier du Texas, est riche d'impressionnantes formations géologiques faisant partie de la Sierra Madre, dont Jodorowsky emprunta le décor, à commencer par le canyon de la Huasteca, à quinze kilomètres de Monterrey (la capitale du Nuevo León), fort apprécié des grimpeurs, et les superbes grottes de García, profondes de plus de 100 mètres. Les deux ensembles font partie du parc national Cumbres de Monterrey.